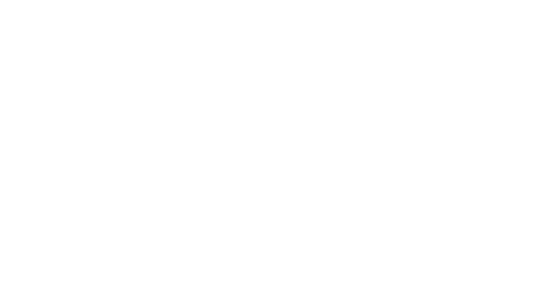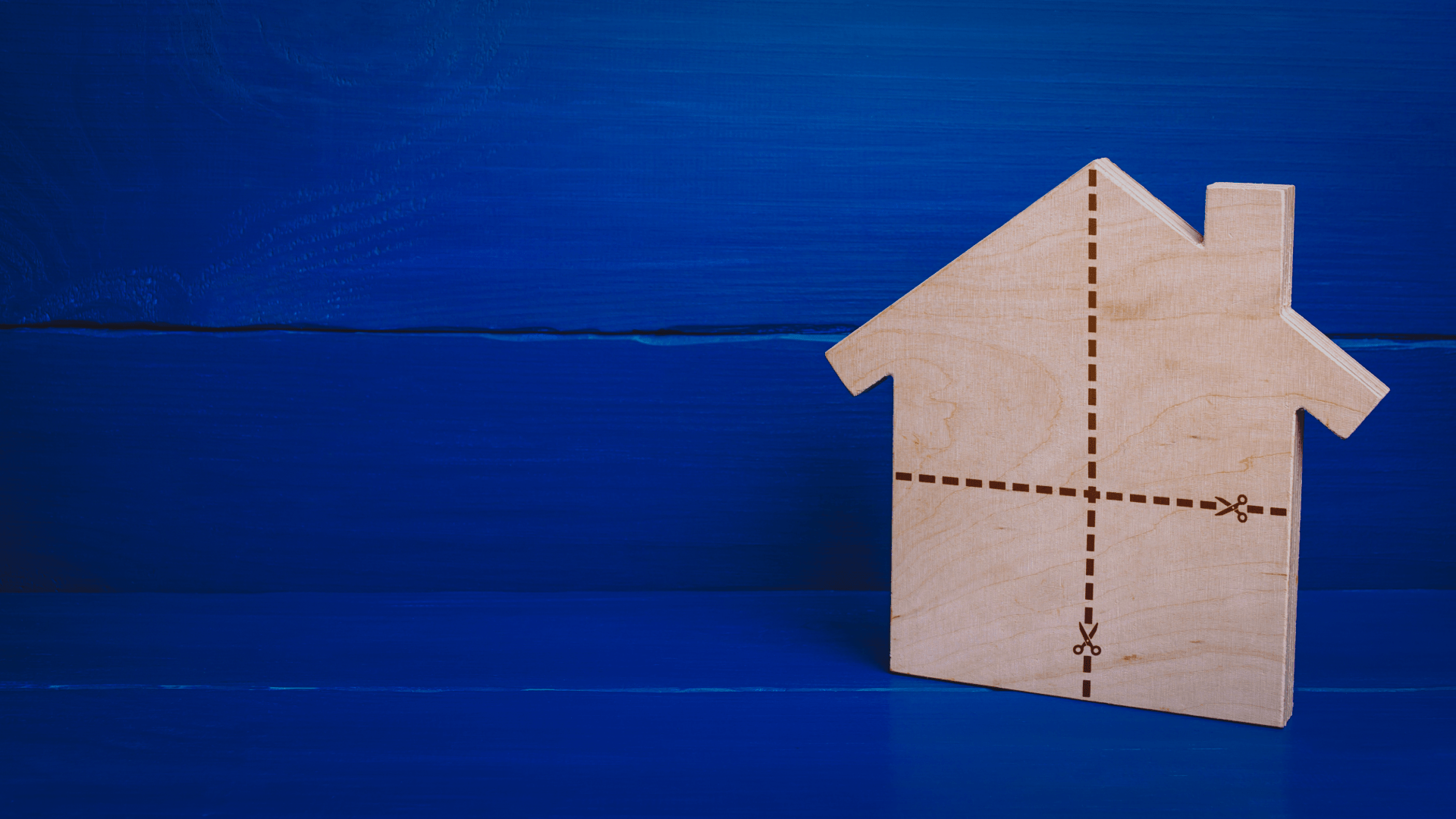Alors que la crise du logement continue de s’intensifier dans les villes belges, un phénomène gagne du terrain : la division de maisons unifamiliales en plusieurs appartements. Il s’agit de transformer une habitation prévue à l’origine pour un seul ménage en plusieurs unités de logement, disposant chacune de leur propre cuisine, salle de bain, et accès indépendant — une manière, en apparence, de multiplier les toits sans poser une seule brique de plus.
Sur le papier, l’idée semble séduisante. Dans un contexte de rareté foncière, utiliser l’existant pour créer de nouveaux logements sans artificialiser les sols s’inscrit dans une logique de densification raisonnable et de durabilité. Pourquoi construire plus loin, quand on peut loger mieux ici ?
Mais derrière cette solution de bon sens se cache une réalité bien plus ambivalente. Le cadre réglementaire, flou et morcelé, rend chaque projet incertain, exposant les propriétaires à l’arbitraire administratif et à des exigences parfois irréalistes. Dans certaines communes, obtenir un permis de régularisation pour une division pourtant ancienne et fonctionnelle relève du parcours du combattant. Ailleurs, ce sont les normes inadaptées ou les délais démesurés qui découragent toute initiative.
À cela s’ajoute un risque plus insidieux : celui d’une densification au rabais, où la quantité prime sur la qualité. Divisions bâclées, logements exigus et mal isolés, entassement dans les greniers ou les caves : ce bricolage de l’habitat nuit autant au cadre de vie qu’à la cohésion urbaine. Ce qui devait être une réponse à la crise devient parfois un facteur d’aggravation.
Entre bonne idée dévoyée, inertie publique et spéculation privée, la division des maisons unifamiliales illustre un défi plus large : comment créer plus de logements sans défaire la ville ? Il est temps de clarifier les règles, d’harmoniser les pratiques et de recentrer les politiques d’urbanisme sur un objectif essentiel : loger dignement, durablement, et sans sacrifier le tissu urbain ni ses habitants.
Une pratique ancienne, un encadrement confus
La transformation de maisons unifamiliales en immeubles à appartements n’est pas un phénomène récent. Jusqu’en 1996 à Bruxelles (et 1994 en Wallonie), ces opérations pouvaient être réalisées sans permis d’urbanisme, à condition qu’elles n’impliquent aucune modification structurelle du bâtiment. Il suffisait, dans de nombreux cas, de cloisonner les espaces, d’installer des compteurs distincts et de louer séparément les unités. Pendant des décennies, ces pratiques ont été tolérées, voire encouragées, dans un contexte où la pression immobilière appelait déjà des solutions flexibles. Résultat : un grand nombre de maisons ont été divisées de facto en deux, trois ou quatre logements — souvent dans le respect des normes de l’époque.
En théorie, ces logements bénéficient aujourd’hui de droits acquis, une notion juridique qui protège les situations établies de longue date, notamment lorsqu’elles remontent à une période où aucun permis n’était requis. Mais en pratique, cette reconnaissance est devenue incertaine, soumise à l’interprétation variable des communes. Le flou juridique ambiant crée un terrain glissant, où les administrations locales jouent un rôle de juge quasi souverain : elles peuvent décider, de manière parfois arbitraire, qu’un bien habité depuis 30 ou 40 ans est illégal, simplement parce qu’il ne figure pas dans les registres urbanistiques les plus récents.
Le résultat ? Une insécurité juridique croissante pour les propriétaires, souvent de bonne foi, qui se retrouvent pris dans une spirale administrative kafkaïenne. À Jette, Uccle, Saint-Gilles, Schaerbeek ou encore Dinant, les témoignages abondent : refus de régularisation pour des motifs techniques irréalistes (manque de local à vélos, absence de caves séparées…), injonctions contradictoires entre le cadastre, la Région et la commune, impossibilité de vendre ou de rénover, et parfois menace de retour à l’état initial, ce qui suppose des coûts colossaux.
Certaines communes à Bruxelles vont jusqu’à exiger que l’on prouve l’existence de la division… avant 1962, date de création des premiers plans de secteur, ce qui relève de l’absurde. Il n’existe souvent aucun document disponible, aucun témoin encore vivant, aucune trace administrative exploitable. Dans ce contexte, le citoyen est abandonné, sans boussole, face à des règles opaques et changeantes. Il ne s’agit plus de garantir un urbanisme cohérent, mais de gérer au cas par cas, dans une logique parfois plus idéologique que juridique.
En somme, ce déficit de clarté et de sécurité juridique menace autant la confiance des citoyens dans l’administration que l’objectif même de création de logements. Il est urgent d’y remédier par une réforme simple, juste et applicable.
Quand les communes deviennent despotiques
Cette dérive, de plus en plus fréquente, pousse certains à parler de despotisme administratif. L’expression n’est pas exagérée lorsque l’on constate à quel point certaines communes exercent un pouvoir discrétionnaire étendu, sans base légale claire ni contrôle juridictionnel effectif. Me Louisa Markarian, avocate spécialisée en droit immobilier, dénonce ainsi « une marge de manœuvre communale excessive », souvent fondée sur des circulaires internes, des interprétations fluctuantes ou des pratiques locales érigées en quasi-droit. Autrement dit, l’urbanisme se gouverne au ressenti plutôt qu’au droit, et ce sont les citoyens qui en paient le prix.
Les exigences imposées pour régulariser des divisions anciennes relèvent parfois de l’absurde : cave individuelle obligatoire, local à vélos en rez-de-chaussée, isolation acoustique conforme aux normes actuelles, surface minimale rigide, hauteur sous plafond irréaliste dans les combles, etc. Ces contraintes, pensées pour les nouvelles constructions, sont tout simplement inapplicables dans des bâtis anciens sans travaux de grande ampleur — et donc, sans coûts prohibitifs. Ainsi, un logement occupé, habitable, fonctionnel, parfaitement entretenu depuis plusieurs décennies, peut être déclaré « illégal » du jour au lendemain, au seul motif qu’il ne respecte pas des normes techniques postérieures à sa division.
La conséquence est doublement néfaste : d’une part, les projets de division qui pourraient créer rapidement des logements de qualité à moindre coût sont découragés ; d’autre part, des biens déjà divisés restent bloqués, invendables ou inexploitables, car leur régularisation est devenue un parcours du combattant.
Pire encore, cette rigidité alimente une zone grise de logements de fait. Confrontés à l’impossibilité de régulariser, certains propriétaires n’ont d’autre choix que de louer sans autorisation, en marge du cadre légal, sans contrôle urbanistique, sans inspection technique, sans protection des locataires. Ce paradoxe est saisissant : au nom de la qualité, on finit par aggraver la précarité. Les pouvoirs publics, en bloquant les filières légales, poussent indirectement au développement d’un marché parallèle, non déclaré et peu encadré.
Il y a donc urgence à rétablir un équilibre entre encadrement et faisabilité. Ce n’est pas en refusant toute évolution du bâti existant qu’on préservera nos quartiers. Bien au contraire : un urbanisme fondé sur la peur, le rejet et la paperasse stérile nuit à la cohésion sociale, à l’offre de logement et à la confiance des citoyens. Les Jeunes MR appellent à un sursaut de bon sens et de justice administrative.
Une densification au rabais ?
Car c’est là que le bât blesse : créer plus de logements ne suffit pas si leur qualité est sacrifiée. La multiplication rapide et non encadrée de petits appartements issus de la division d’anciennes maisons unifamiliales engendre souvent ce que l’on pourrait qualifier de densification au rabais. Ces logements sont fréquemment caractérisés par des défauts structurels importants : isolation thermique et phonique insuffisante, ventilation inadéquate, manque de lumière naturelle, voire des espaces de vie exigus et mal distribués.
Dans de nombreux cas, les espaces autrefois dédiés à la vie familiale – jardins, cours, caves, greniers – sont transformés en logements, parfois sans respecter les conditions minimales de salubrité et de confort. Les caves deviennent des studios sans fenêtre, exposant les occupants à un risque accru d’humidité et de mauvaise qualité de l’air. Les greniers, souvent sous des toits en pente et avec une faible hauteur sous plafond, sont aménagés en chambres précaires, loin des standards d’habitabilité.
Ce simple empilement de surfaces ne correspond en rien à une vision d’urbanisme intelligent et durable. Il s’agit davantage d’une logique quantitative que qualitative, où l’augmentation brute du nombre de logements prime sur le bien-être des habitants et la qualité de vie dans les quartiers.
Mais les conséquences ne s’arrêtent pas aux seuls logements eux-mêmes. Cette densification mal maîtrisée entraîne une pression excessive sur les infrastructures locales. Le stationnement devient problématique, faute de places suffisantes pour les nouveaux résidents, créant des conflits avec les riverains historiques. Les réseaux d’évacuation des eaux, les espaces verts, les équipements publics sont sollicités au-delà de leur capacité.
Par ailleurs, ces divisions mal régulées peuvent provoquer une dégradation du tissu social. En morcelant les grandes maisons familiales en micro-logements souvent destinés à des publics précaires ou instables, on fragmente les communautés, réduisant la mixité sociale et la stabilité des quartiers. L’absence de règles claires favorise parfois la concentration d’occupants à faibles ressources, sans accompagnement, ce qui peut accroître les tensions sociales, les nuisances et l’insécurité perçue.
Loin de revitaliser les quartiers, ces pratiques peuvent au contraire accélérer leur détérioration, alimentant un cercle vicieux où l’offre de logement se dégrade, les investisseurs fuient et le cadre de vie des habitants historiques se dégrade.
Une politique d’urbanisme responsable ne peut se contenter de compter les mètres carrés créés. Elle doit garantir un équilibre entre quantité et qualité, afin que chaque logement soit un lieu sain, durable et intégré dans un environnement urbain harmonieux et viable sur le long terme.
À rebours de la colocation solidaire
Le phénomène contraste fortement avec l’essor récent de la colocation ou du coliving, que nous avions analysé dans un précédent article. Là où le coliving s’inscrit dans une démarche volontaire de réinvention du vivre-ensemble, en mettant l’accent sur la mutualisation des espaces communs, la création de liens sociaux, et parfois même la solidarité intergénérationnelle, la division traditionnelle d’un bien immobilier en micro-logements répond souvent à une logique strictement économique et spéculative.
Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas de bâtir un projet de vie collective ou de favoriser la convivialité. Il n’y a ni volonté de créer des espaces partagés, ni ambition sociale autre que la rentabilité maximale au mètre carré. Chaque logement est considéré comme un simple produit immobilier, monétisé au prix fort, souvent sans prendre en compte les besoins réels des occupants, ni les impacts sur le quartier.
Cette approche peut ainsi se révéler exclusionnaire, puisqu’elle s’adresse fréquemment à des locataires précaires contraints d’accepter des conditions de vie réduites, dans des logements parfois trop petits, mal isolés et peu confortables. Le modèle tourne alors à une forme de marchandisation brutale du logement, au détriment des valeurs de mixité sociale, de qualité de vie et d’intégration urbaine.
Pourtant, l’idée initiale à la base de ces divisions — densifier le parc immobilier existant afin de répondre à la crise du logement — demeure une piste valable et nécessaire. Face à la pression démographique et aux besoins croissants, il est essentiel d’optimiser l’usage du bâti ancien plutôt que d’étendre sans fin la périphérie urbaine.
Mais cette densification doit s’inscrire dans un cadre réfléchi, responsable et qualitatif. Il ne suffit pas de diviser un bâtiment pour créer des logements : il faut avant tout loger dignement, en garantissant la sécurité, le confort, la salubrité et un cadre de vie équilibré. Il faut penser les logements comme des lieux de vie, intégrés dans un projet d’aménagement urbain cohérent, capable de concilier les besoins des habitants, la protection de l’environnement et la pérennité des quartiers.
En somme, densifier ne signifie pas empiler ; la densité choisie doit être une opportunité d’améliorer la qualité de l’habitat, non une excuse pour abaisser les standards et exclure les plus vulnérables.
Vers un encadrement clair, juste et pragmatique
La solution ne se trouve ni dans une interdiction systématique, qui figerait le parc immobilier existant et priverait la Région de logements indispensables, ni dans un laxisme total, qui ouvrirait la porte à une fragmentation anarchique et à une dégradation qualitative des habitats. Elle repose au contraire sur trois piliers fondamentaux, complémentaires et nécessaires pour concilier développement, qualité et justice sociale.
- Un cadre juridique clair, harmonisé à l’échelle régionale, est la première condition indispensable. Aujourd’hui, le flou et les divergences entre communes créent une insécurité juridique préjudiciable aux propriétaires comme aux candidats locataires. Il faut définir clairement les critères qui permettent de reconnaître les divisions anciennes, afin de garantir aux occupants un statut légal stable et aux autorités locales un référentiel unique. Ce cadre doit également limiter le pouvoir discrétionnaire des communes, qui, dans certains cas, s’apparente à un arbitraire administratif injustifié. Une harmonisation régionale permettra de sécuriser les démarches de régularisation, de diminuer les contentieux et de faciliter les investissements dans la rénovation et la transformation durable du bâti.
- Des normes proportionnées, adaptées à la réalité des constructions existantes, sont également cruciales. Il est illusoire et contre-productif d’imposer les standards techniques et architecturaux d’un immeuble neuf – comme une isolation thermique dernier cri, un local à vélos obligatoire, des hauteurs sous plafond modernes – à des maisons construites il y a un siècle, souvent avec des matériaux et des techniques différentes. Ces exigences trop rigides conduisent à un phénomène de rejet, car elles rendent la régularisation financièrement inaccessible pour les propriétaires et les investisseurs. Les normes doivent donc être modulées, conciliant exigences de sécurité et de confort avec faisabilité technique et respect du patrimoine bâti. Cette approche pragmatique favorisera la création de logements décents sans sacrifier la viabilité économique des projets.
- Une vision urbanistique globale, intégrant les divisions dans une planification cohérente, est enfin essentielle pour garantir un développement harmonieux des quartiers. La densification ne doit pas se faire au détriment des infrastructures publiques, des espaces verts, de la mobilité douce ou de la mixité fonctionnelle. Il faut que chaque projet s’inscrive dans une stratégie territoriale plus large, prenant en compte l’impact sur le stationnement, les transports en commun, les équipements scolaires et culturels, ainsi que sur la qualité de vie des habitants. Cette planification doit aussi favoriser la mixité sociale, en évitant la concentration exclusive de logements précaires ou le morcellement qui fragilise la cohésion communautaire. En d’autres termes, l’urbanisme doit être pensé comme un levier de qualité de vie, et non comme une simple addition de mètres carrés.
En adoptant cette triple approche, la Région bruxelloise et les autres entités pourront à la fois répondre à l’urgence de la crise du logement et préserver un cadre de vie digne, équilibré et durable. Les Jeunes MR soutiennent cette démarche pragmatique et responsable, convaincus que la modernisation du parc immobilier passe par l’innovation, le dialogue et un cadre clair, à la hauteur des enjeux actuels.
Réinventer la densité sans dégrader la ville
En conclusion, il est urgent de dépasser le dilemme stérile entre une permissivité sauvage, qui sacrifie la qualité et la sécurité au profit du seul nombre, et un blocage autoritaire, qui freine toute évolution nécessaire. La densification du parc immobilier est inévitable, voire indispensable, dans un pays où la pénurie de logements pèse lourdement sur des milliers de ménages.
Mais cette densification ne peut être une fin en soi : elle doit être pensée dans une logique qualitative, solidaire et durable. Refusons la fragmentation anarchique de nos quartiers en studios insalubres et mal conçus, qui dégradent à la fois le bâti et la cohésion sociale.
Construisons plutôt une ville à taille humaine, où chaque logement respecte la dignité des habitants, offre un confort réel et garantit un cadre de vie harmonieux. C’est à cette condition que la division des maisons unifamiliales pourra enfin cesser d’être un problème et devenir une véritable solution d’avenir face à la crise du logement.
Les Jeunes MR appellent à un engagement clair des pouvoirs publics, à une réglementation équilibrée et à une politique urbaine ambitieuse, pour que Bruxelles et la Wallonie deviennent des territoires où l’habitat est synonyme de qualité, d’équité et de respect des citoyens.