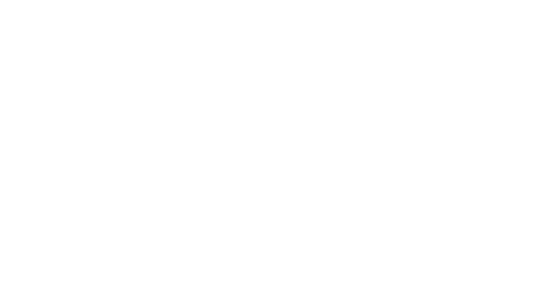A vous toutes et tous, jeunes et moins jeunes, libéraux ou non.
La sécurité, ce n’est pas uniquement l’affaire de « la droite ». Ce n’est pas seulement la première des libertés. C’est surtout la première des stabilités sur laquelle est construite un Etat abritant la destinée de ses millions d’habitants.
Au-delà des clivages gauche-droite et d’un manque de volonté d’y consacrer les budgets suffisants, une erreur régulièrement commise concerne la définition-même du mot « sécurité ».
Dès la fin du 20ème siècle, l’Ecole de Copenhague, et plus spécifiquement l’auteur Barry Buzan, mettait l’accent sur les aspects multifactoriels de la sécurité, en arguant que toute problématique pouvait être appréhendée selon l’impact que cette dernière provoque dans plusieurs secteurs : politique, militaire, économique, social et environnemental.
Au plus une thématique comporte des répercussions dans ces cinq secteurs, et à la mesure de leur gravité, au plus vous pouvez considérer qu’elle met en danger la sécurité nationale.
Cette dernière représente donc quelque chose de bien plus complexe qu’un combo « police – Justice – prisons » et les exemples que l’actualité nous offre tous les jours le démontrent : de l’incursion des drones au-dessus d’infrastructures critiques à la lutte contre le trafic de drogue, en passant par la sécurité numérique, la radicalisation des jeunes ou encore le bien-être de toutes les franges de la société dans l’espace public, il s’agit d’un concept hybride qui mêle tant la présence concrète d’une menace physique sur tout ou partie de la population que la sensation ou l’inquiétude d’être oui ou non en sécurité.
Politiquement, cela concerne évidemment au premier chef les Ministres de la Sécurité et de l’Intérieur et de la Justice, mais également toutes les autorités publiques et la société civile. L’ensemble de ces composantes constitue une chaîne de maillons indissociables et dont l’union est, de façon rédhibitoire, tributaire d’une solidarité mutuelle à toute épreuve.
L’heure n’est plus à désigner son interlocuteur pour savoir « qui doit faire quoi ? », mais à s’organiser pour le faire efficacement, quitte à se doter d’indicateurs et d’audits clairs afin de quantifier et documenter les efforts individuels et collectifs mis en œuvre en matière de sécurité.
Cette dernière affirmation fait sans transition le lien avec une deuxième erreur trop régulièrement commise, à savoir l’absence d’une véritable « culture de la sécurité ».
Cette dernière devrait se muer tant en la première des stabilités dans une démocratie libérale qu’en une valeur transversale guidant l’action de chaque autorité publique à l’instar de ce qui se fait ailleurs.
On regarde souvent, à raison, vers nos voisins du nord, et pas seulement vers la Flandre, lorsqu’il s’agit de réformer les institutions publiques en matière de sécurité.
Il est vrai qu’aux Pays-Bas, la stratégie nationale repose sur des valeurs sûres, telles que la coordination interministérielle, des partenariats public-privé et la prévention via l’éducation, la sensibilisation et la cybersécurité.
La sécurité de l’État et la tranquillité dans nos rues dépendent aussi de l’implication de chacun. Citoyens, entreprises et autorités ont tous un rôle à jouer. Cette vigilance collective rend les dispositifs publics plus efficaces et aide à construire une société vraiment plus sûre. A bon entendeur…
Des différents chantiers belges en cours en matière de sécurité, évoquons-en un, pourtant présent dans l’Accord de Gouvernement, mais dont l’accouchement aura précisément témoigné d’une culture de la sécurité défaillante en Belgique. Je vise évidemment le projet de loi relatif à l’interdiction (…) des associations ou groupements constituant une menace grave et actuelle pour la sécurité nationale.
De très nombreuses personnes et associations accusent déjà le Gouvernement et singulièrement le Ministre de l’Intérieur de vouloir se doter, grâce à ce projet de loi, d’un outil arbitraire destiné à faire taire toute voix contestataire. Protéger la société belge doit devenir et rester une priorité absolue. Pour autant, il ne sera jamais dans l’intention des libéraux d’installer un Etat au tout-sécuritaire.
Concrètement, s’il existait encore des doutes quant à la procédure appelée à être en définitive coulée en force de loi, ce serait toujours uniquement sur base des rapports des services de renseignement que le Ministre de l’Intérieur pourrait proposer l’interdiction d’une association radicale.
Cette interdiction devrait ensuite faire l’objet d’un consensus politique au sein du Gouvernement ET pourrait toujours faire l’objet d’une procédure de recours juridique, tant devant le Conseil d’Etat et les cours et tribunaux.
Disons-le clairement : les syndicats, les partis politiques ou encore les organisations (associations, ONG,…) dont l’objet social réel est animé par de nobles intentions et légitimes d’un point de vue légal sont explicitement exclus du champ d’application de ce projet de loi.
Seules les personnes mal informées ou de mauvaise foi vous diront le contraire.
Concrètement, sur base des exemples précités, seraient donc susceptibles d’être frappées d’interdiction les entités / organisations se rendant notamment coupables d’actes de terrorisme.
Il ne suffira donc pas de se livrer à des troubles à l’encontre de l’ordre public, tels que des jets de projectile sur des militants en marge d’une conférence dans une université (toute ressemblance avec de semblables événements récents ne pourrait être que fortuite…).
Seules seront visées les organisations dont le réel objectif n’est pas louable mais visant bel et bien à saper les fondements-mêmes de la démocratie libérale et de la sécurité nationale. Dans le respect absolu de l’Etat de droit, trouvez-moi un interlocuteur, démocrate ou non, qui soit contre l’interdiction de ces associations radicales. Et nous en débattrons. C’est ça la démocratie libérale.
En conclusion, les Jeunes MR plaident pour que la sécurité ne soit plus considérée comme une simple variable d’ajustement budgétaire. La sécurité doit devenir une valeur d’intérêt général. Pour y parvenir, une législature (qu’on permet de parvenir à son terme…) n’est pas suffisamment longue afin d’agir sur les consciences collectives. Cependant, dans la mesure de nos moyens, nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice. Et cette œuvre commence… hier.

Garry Moës
Délégué Justice, Intérieur, Sécurité, Défense et Protection des libertés individuelles