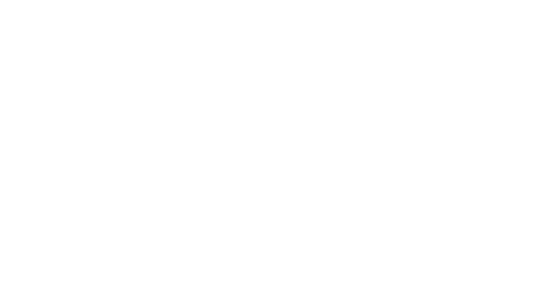Dans un débat saturé de symboles, il est essentiel de rappeler que le droit international repose autant sur des principes que sur le pragmatisme. Reconnaître un État palestinien peut être un geste politique fort, mais cela ne sauvera ni les civils de Gaza, ni les otages israéliens, ni ne relancera un véritable processus de paix. La priorité, aujourd’hui, c’est d’obtenir un cessez-le-feu durable. Et pour cela, deux leviers doivent être mobilisés : la diplomatie et la pression économique.
Ce que dit le droit, ce que montre le réel
Un État repose sur trois critères : un territoire, une population, une autorité effective. La Palestine ne les remplit qu’imparfaitement. Territoires morcelés, population sous double autorité (une Autorité palestinienne vieillissante et affaiblie et un Hamas reconnu comme groupe terroriste). Le droit à l’autodétermination du peuple palestinien est indiscutable, mais la reconnaissance d’un État inexistant sur le terrain, sans contrôle ni unité, serait purement symbolique.
Deux volontés irréconciliables
Le blocage est clair : les dirigeants palestiniens refusent historiquement de reconnaître Israël, tandis que le gouvernement israélien poursuit une politique d’expansion, en Cisjordanie comme à Gaza, avec des velléités d’annexion ou de contrôle (militaire) permanent. L’un refuse toujours de reconnaître la légitimité de son voisin, l’autre cherche à s’approprier des territoires par la force ou la colonisation : dans ces conditions, une reconnaissance unilatérale ne ferait que valider un statu quo explosif.
Une diplomatie pragmatique
Un cessez-le-feu ne pourra être imposé que par une pression diplomatique coordonnée, impliquant les voisins influents (Égypte, Turquie, Arabie saoudite) et surtout la Ligue arabe. Ni l’Europe ni les États-Unis, seuls, ne peuvent forcer une issue durable. C’est par une médiation régionale et des garanties croisées qu’une désescalade peut s’enclencher.
L’économie, levier complémentaire
L’Union européenne est le premier partenaire commercial d’Israël avec 34 % de ses échanges extérieurs. En 2023, elle a importé pour 30 milliards d’euros de biens israéliens et exporté pour plus de 20. Ce lien structurel est un levier. Les sanctions ne suffisent pas toujours, comme le montre l’exemple russe, mais appliquées de manière ciblée, elles peuvent peser. Israël, pays ouvert, démocratique, intégré aux chaînes occidentales, est sensible à la pression économique. L’objectif n’est pas de punir, mais d’arrêter une guerre qui n’a plus aucune justification.
Deux États, mais une seule urgence : la paix
Lorsque les combats cesseront, que les otages auront été libérés, le Hamas démantelé et l’aide humanitaire autorisée, alors viendra le temps de reconstruire Gaza, de rebâtir un leadership palestinien crédible, et de poser les fondations d’un véritable État.
Des actes, pas des mots
La reconnaissance de la Palestine devra venir, mais pas pour satisfaire une émotion ou une posture. Elle devra intervenir lorsqu’elle permettra un vrai pas vers la paix, pas avant. Tant que les conditions ne sont pas réunies, ce geste restera creux. Ce que les mots n’obtiennent plus, seule une stratégie cohérente et des leviers bien utilisés, comme les sanctions économiques ciblées, peuvent encore imposer.